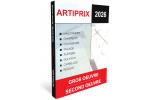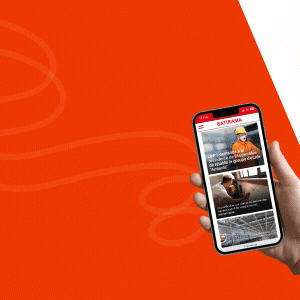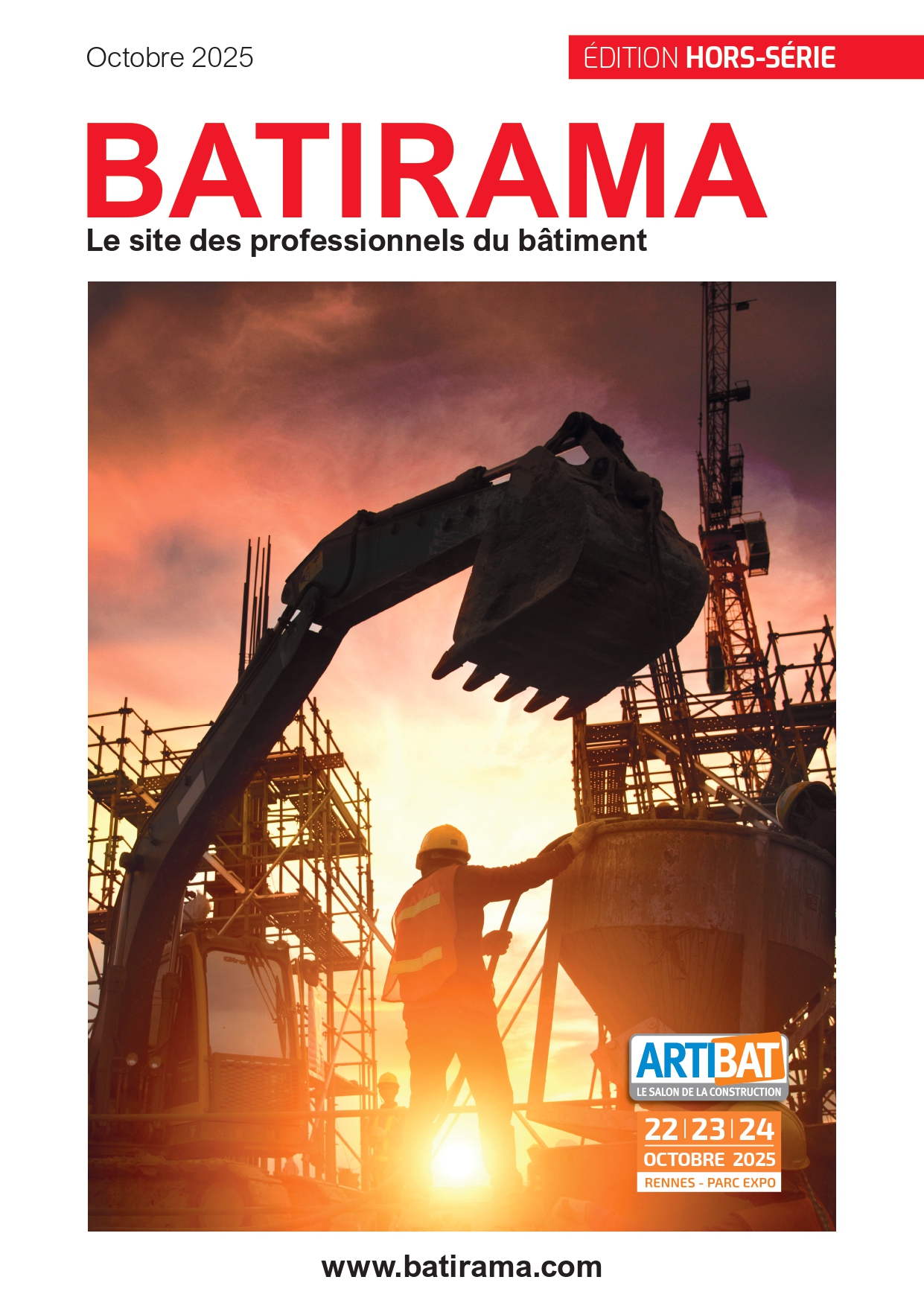Un projet de loi transpose 75 textes européens, notamment sur l’énergie et les bâtiments

Un projet de loi a été adopté en conseil des ministres le 10 novembre. Il transpose 32 directives et adapte le droit français à 43 règlements européens : l’énergie, l’environnement et les bâtiments sont concernés.
Tout a été fait, avec retard, mais dans l’ordre. La Directive RED III du 18 Octobre 2023, portant sur les énergies renouvelables, aurait dû être transposée entièrement. Elle ne l’est toujours pas tout à fait. Mais le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (Ddadue) a été soumis au Conseil d’État le 5 septembre, avant son adoption en Conseil des ministres.
Le Conseil d’État a rendu un avis détaillé sur les 70 articles et 177 pages de ce texte. L’avis commence par une remarque générale : le "Conseil d'État constate que le volume et la technicité croissantes des normes européennes, qui peuvent cependant être incomplètes sur certains points, l’effacement progressif de ce qui distingue une directive et un règlement, le recours de plus en plus fréquent à des règlements ou directives renvoyant leurs mesures d’exécution à des règlements ou directives ultérieurs, rendent l’adaptation au droit de l’Union toujours plus complexe et délicate, ainsi que le Conseil d’État l’avait souligné dès 2014 dans son étude Directives européennes : anticiper pour mieux transposer". Bref, c’est compliqué même pour les conseillers d’État. Deuxièmement, continue le Conseil, une partie des "dispositions du projet de loi reproduisent des articles de règlements de l’Union européenne". Ce qui n’est absolument pas nécessaire.
L’effacement électrique remplacé par des dispositions plus étendues
RTE se voit confier un rôle plus étendu dans l’équilibrage du marché électrique (Titre V et articles 36 et 37 du projet de loi) et dans la gestion du marché de la flexibilité électrique, soit l’ensemble des actions visant à favoriser l’équilibre des réseaux électriques par des actions de gestion de la demande, qu’il s’agisse de réduction ou d’accroissement du soutirage, et de gestion de la production par la mobilisation rapide de capacités disponibles préalablement identifiées. Ces nouvelles dispositions remplacent celles qui régissaient l’effacement.
RTE gérera le dispositif de flexibilité, à la fois du point de vue technique et dans l’organisation des es procédures d’appels d’offres et de contractualisation qui seront, comme les règles tarifaires, placées sous la surveillance de la Commission de régulation de l’énergie. "Dans ce cadre, indique le conseil d’État, le dispositif de flexibilité repose sur les offres des acteurs de marché – fournisseurs d’électricité et agrégateurs d’effacement – et sur la participation active des consommateurs à des actions de modulation de la demande".

La place accrue des énergies renouvelables dans les bâtiments, les transports et l’industrie, notamment de l’électricité, mais aussi du biogaz, est consacrée par ce projet de loi. © PP
Dans le même temps, les consommateurs d’électricité seront mieux protégés. Tout d’abord, les éléments qui doivent être communiqués aux consommateurs à propos de leurs contrats sont définis. Ensuite, les fournisseurs d’électricité les plus importants devront proposer une offre de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée, comportant un engagement d’un an minimum sur le prix. Enfin, ce projet de loi contient la mise en œuvre de mesures d’urgence pour protéger certains consommateurs des augmentations brutales du prix de l’électricité, lorsque le Conseil de l’Union européenne a déclaré une crise des prix de l’électricité à l’échelle de l’Union européenne ou à une échelle régionale incluant la France. Les consommateurs domestiques et des consommateurs "éligibles", désignant les entreprises au-dessous d’un seuil fixé par la loi, seront concernés. Les TPE devraient être contentes.
Le gaz et l’hydrogène
L’article 38 du projet de loi transpose le quatrième "paquet gaz" européen qui porte sur le gaz naturel, sur le gaz d’origine renouvelable et sur l’hydrogène. Ce paquet gaz est issu de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.
Le quatrième "paquet gaz" encourage le développement de gaz d’origine renouvelable et organise la diminution anticipée du recours au gaz naturel fossile. Il crée aussi le cadre d’un marché européen de l’hydrogène, largement inspiré par le cadre existant pour l’acheminement et la commercialisation du gaz naturel. Les dispositions nouvelles encadrent le stockage et le transport d’hydrogène et l’exploitation des terminaux de regazéification de l’hydrogène, définissent les relations entre les opérateurs de ces activités et les règles tarifaires et contractuelles applicables à leurs activités. La Commission de régulation de l’énergie est chargée de la surveillance de ce nouveau marché. Des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène devront être désignés. Il n’est pas prévu, pour l’instant, de gestionnaire de réseau de distribution de l’hydrogène. Les gestionnaires des réseaux de distribution pourront approvisionner directement les clients finaux.
Le projet de loi prévoit le changement d’usage des réseaux de gaz naturel qui seraient, à l’avenir, consacrés à l’hydrogène, pour lesquels la directive prévoit un transfert de l’autorisation d’exploitation, en l’assortissant des contrôles administratifs propres à assurer la sécurité technique de ce nouvel usage et à en prévenir les risques. Enfin, le projet envisage la possibilité de réduire le nombre et l’étendue des réseaux gaz, en confiant aux autorités organisatrices le pouvoir de créer des zones d’interdiction de raccordement, à partir d’études réalisées par les gestionnaires de réseaux, et en réservant aux communes un droit d’opposition à la création de ces zones sur leur territoire.

La place de l’hydrogène est consacrée par le projet de loi, avec de nouvelles dispositions sur l’hydrogène dans les transports et sur les réseaux de transport de l’hydrogène. © France Hydrogen
Energies renouvelables, biomasse et biocarburants
Le projet de loi prévoit la création de zones dites "d’accélération renforcée pour le développement des projets de production d’énergie à partir de sources renouvelables" ainsi que de "zones d’implantation d’infrastructures de réseau". Il instaure une évaluation environnementale préalable qui permet ensuite de dispenser les projets d’installations de production d’énergie renouvelable et les projets d’infrastructures de réseau, implantés à l’intérieur de ces zones d’accélération renforcée, d’être à nouveau soumis à une évaluation environnementale ainsi qu’à une évaluation d’incidences Natura 2000.
En ce qui concerne la biomasse, le projet de loi modifie le régime des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, des liquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse, en élargissant le champ des installations concernées et en complétant les critères pour la biomasse forestière.


Le projet de loi introduit le "principe d’utilisation en cascade" de la biomasse qui donne la priorité, chaque fois que c’est possible, à l’usage matériel de la biomasse avant son usage énergétique. © PP

À propos des biocarburants, les Directives Européennes RED II et RED III obligent les États Membres à s’assurer que les volumes de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables et fournies au secteur des transports entraîne une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 par rapport à la valeur de référence. © PP
Pour parvenir à respecter les Directives RED II et RED III en France, le projet de loi lance un dispositif d’échanges de certificats, dénommé "Incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants" (IRICC). Fondé sur des objectifs de réduction de l’intensité en carbone assignés à chaque fournisseur de carburants redevable de l’accise sur les énergies, ce dispositif se traduit par l’obligation de détenir des certificats à hauteur de ces obligations, prenant en compte l’utilisation de carburants renouvelables, comme les biocarburants, le biogaz ou les carburants renouvelables d’origine non biologique, ainsi que de l’électricité renouvelable dans le secteur des transports. Le dispositif est assorti de pénalités sanctionnant les manquements à ces obligations. C’est un mécanisme qui ressemble un peu à celui des CEE.
Ce nouveau IRICC doit remplacer la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), dont l’abrogation est prévue à compter du 1er janvier 2027 dans le projet de loi de finances pour 2026.
La performance énergétique des bâtiments
Les différences entre les obligations françaises (art. L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation) et celles de l'article 10 de la directive (UE) 2024/1275 s’agissant du déploiement des installations de production d’énergie renouvelable sur les toitures des bâtiments, de leurs extensions ainsi que des parkings couverts, ont conduit le Gouvernement a choisi d’aligner strictement la réglementation française sur les exigences de la directive. Ce qui réduit les exigences pour bâtiments existants tertiaires et les augmente pour les bâtiments résidentiels neufs.
En tertiaire existant, la possibilité française de végétaliser ou de solariser les toitures disparaît. Seule reste la solarisation.
L’article 45 du projet de loi définit ce qu’est une rénovation importante : "la rénovation d’un bâtiment est dite importante lorsque le coût des travaux portant sur l’enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors valeur du terrain sur lequel il se trouve". Le même article indique que "toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d’un parc de stationnement ou qui procède à une rénovation importante, incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment, le dote de points de recharge pilotables et d’infrastructures permettant la mise en place de points de recharge pilotables des véhicules électriques et hybrides rechargeables". Les détails concrets sont renvoyés à un décret en conseil d’État qui fixe les modalités d’application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l’obligation s’applique et les conditions d’adaptation en fonction de l’usage du bâtiment, ainsi que le nombre ou le taux d’emplacements concernés dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Le projet de loi introduit l’obligation d’une production d’EnR sur site (art. 45) en construction neuve à compter du 1er janvier 2030 et aux rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au premier alinéa ayant une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, et, à compter du 1er janvier 2028, à celles ayant une emprise au sol de plus de 270 mètres carrés. © PP
Le texte précise encore : "doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables les bâtiments ou parties de bâtiments publics non-résidentiels dont l’emprise au sol est supérieure à :
– 1 100 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2028 ;
– 410 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2029 ;
– 130 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2031".
Dans le champ de l'industrie et de l'environnement, le projet complète les règles relatives à la prévention du bruit, notamment dans le secteur aérien, ainsi qu'à la gestion des déchets et des emballages, notamment dans le but de réduire la quantité d'emballages et de déchets d'emballage mis sur le marché.
Un vaste ensemble de décrets, d’arrêtés, voire d’ordonnances doit encore déterminer quantités de dispositions. Tout cela devrait apparaître peu à peu au cours de 18 mois à venir.
L'auteur de cet article