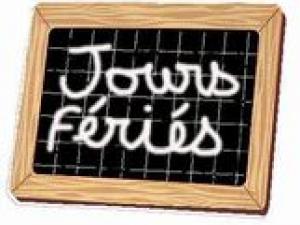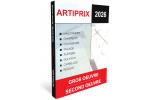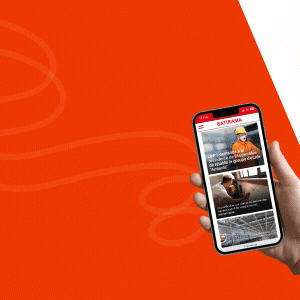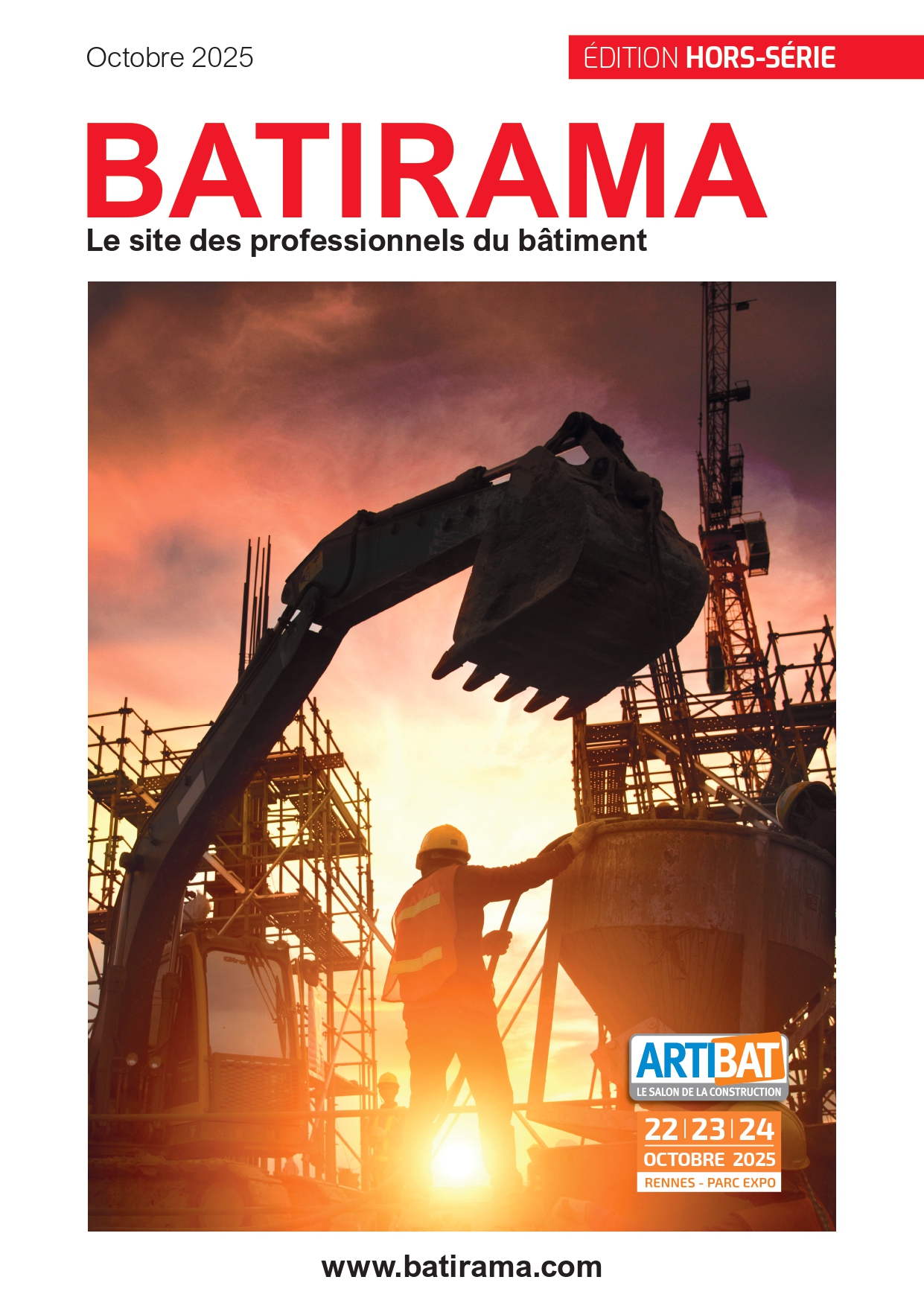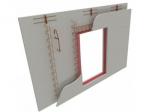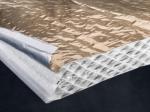Droit du travail : tout ce qui a changé au cours de l'été 2025

L’été aura été riche au niveau du droit du travail : réforme des saisies sur salaire, congés payés et arrête maladie, ... L'occasion pour l'avocat François Taquet de faire le point.
L’été aura été riche au niveau du droit du travail, notamment en ce qui concerne la question des salaires. Il n'est donc pas inutile de faire le point.
Réforme des saisies sur salaire : ce qui a changé depuis le 1er juillet 2025
Depuis le 1er juillet 2025, les procédures de saisie des rémunérations ne sont plus gérées par les greffes des tribunaux judiciaires, mais par les commissaires de justice (nouvelle appellation des huissiers de justice).
Pratiquement, les versements ne se font plus au greffe mais à un commissaire de justice répartiteur, après réception d’une notification officielle.
Un salarié qui tombe malade durant ses congés payés peut-il les reporter ultérieurement ?
La Commission européenne somme la France de respecter le droit européen, qui permet aux salariés de rattraper leurs jours de congés ultérieurement, si jamais ils sont en arrêt maladie pendant leurs vacances. Après le séisme de l'année 2024 relatif au droit à congés payés d’un salarié pendant une période de maladie, le sujet risque de rebondir avec un thème voisin. Le problème peut être résumé en une phrase : un salarié qui tombe malade durant ses congés payés peut-il les reporter ultérieurement ?
Pour la Cour de cassation, un salarié qui tombe malade au cours de ses congés ne peut ni demander leur report ou leur prolongation (Cass soc., 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-44907). En revanche il pourra prétendre au paiement de ses congés payés ainsi qu’aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Le problème est que la Cour de justice de l'Union européenne considère que le congé annuel payé a pour but de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. La Cour fait donc la différence entre le droit à repos (maladie) et le droit à loisir (congés). Ainsi, si un salarié est malade, il ne peut profiter de loisirs. Théoriquement, il appartient donc à l’employeur de rattraper ces jours de congés plus tard. La Commission européenne a décidé, le 18 juin 2025, de mettre la France en demeure et lui donne deux mois pour se mettre en conformité.
Entre temps, une décision de la Cour de cassation est attendu le 10 septembre 2025 sur cette question. Et, sauf surprise, la Cour devrait opérer un revirement de jurisprudence et aligner sa position sur celle de la CJUE. Déjà le ministère du Travail a affirmé que les entreprises "sont déjà censées appliquer" cette règle.
En quoi la directive européenne sur la transparence des salaires va concerner les entreprises ?
La nouvelle directive européenne sur la transparence des salaires est progressivement intégrée au droit français. Son objectif, d’ici au 7 juin 2026, est clair : garantir l’équité salariale au sein des entreprises.
Attention certaines questions ou mentions ne pourront plus être d’actualité :
– demander le salaire actuel ou passé des candidats ;
– Publier une offre sans mentionner la rémunération (montant ou fourchette claire) ;
– Utiliser "salaire à négocier" ou "selon profil" sans préciser de montant dans les annonces ;
– Omettre d’informer sur la convention collective applicable dans l’offre ou dès le début du process ;
– Insérer une clause interdisant au salarié de parler de son salaire à ses collègues….
Peut-on licencier un salarié alors alors qu’une rupture conventionnelle est en cours… ?
Pour être plus précis, un employeur peut-il licencier un salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation (de 15 jours) et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ? Oui, pour la Cour de cassation (Cass soc. 25 juin 2025. pourvoi n° n° 24-12096). En revanche, le licenciement n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle, mais a seulement pour effet de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention. Ce qui a pour conséquence que le salarié a le droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
L'auteur de cet article