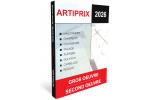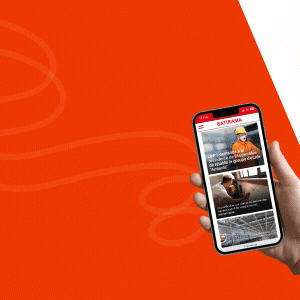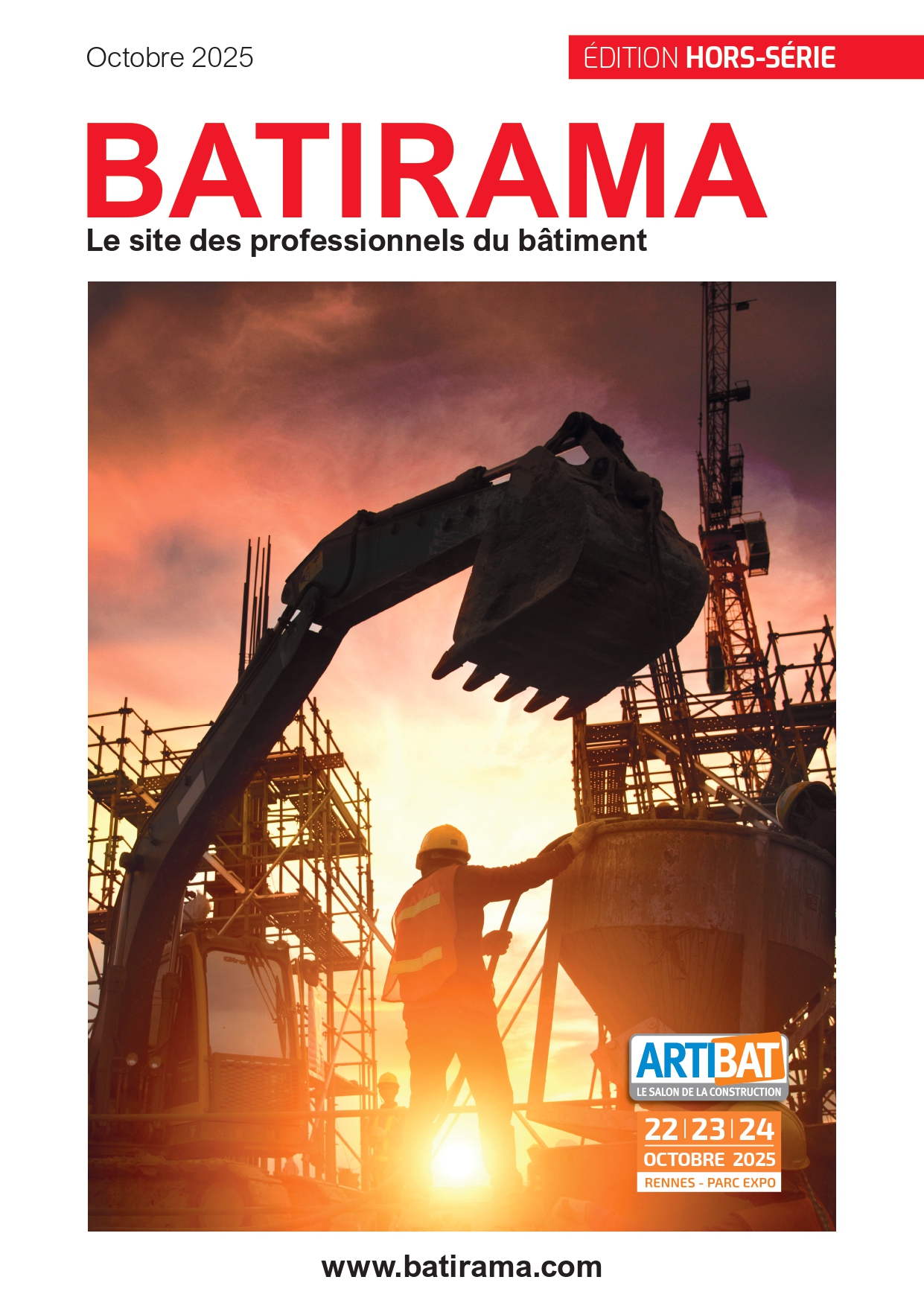Les carrières, véritable vivier de découvertes archéologiques

Une convention cadre vient d’être signé entre l’INRAP et l’UNICEM. L’objectif est de faciliter la coordination des fouilles dans les carrières, qui regorgent bien souvent de vestiges archéologiques.
Quel est le point commun entre le squelette de mammouth retrouvé quasi-complet à Changis-sur-Marne, les vestiges d’une exploitation agricole gauloise excavée à Prasville en Eure-et-Loire ou encore la batterie d’artillerie de la Première guerre mondiale sortie de terre à Villevaudé en Seine-et-Marne ? Ces trois découvertes archéologies ont toutes eu lieu sur le terrain d’une carrière.
Parce qu’ils brassent le sol, potentiellement chargé d’histoire, les exploitants de carrières sont à l’origine de nombreux sites de fouilles archéologiques en France. Le site de l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventive) met en lumière plus d’une trentaine de sites archéologiques situés sur des carrières actuellement en exploitation. "L’archéologie doit beaucoup aux carrières pour de nombreuses découvertes intéressantes", explique Etienne Fromentin, secrétaire général Normandie et Hauts-de-France de l’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction). De plus en plus, les deux professions – exploitants et archéologues – coordonnent leurs activités pour être plus efficaces.
.jpg)
Les fouilles d’une voie gallo-romaine IIIe siècle situé sur la carrière La Masure à Boquet, Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne), 2012. © Céline Casasoprana, Inrap.
Des fouilles en permanence sur les carrières en France
En France, avant une quelconque activité d’extraction du sol d’une carrière, chaque nouveau site ou chaque extension est scrupuleusement étudié par l’INRAP. "On ne crée pratiquement plus de nouvelles carrières en France seulement quelques unités par an", resitue Olivier Viano, secrétaire général de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG). "L’immense majorité des nouvelles exploitations sont des extensions des carrières existantes."
On recense ainsi entre 2 500 et 3 000 carrières en France qui réalisent en permanence des extensions, tous les 10 ou 15 ans en moyenne. Autant de cas où une procédure est engagée avant l’exploitation pour assurer une prévention archéologique. Cette procédure se déroule en deux étapes :
– d’abord l'INRAP, via son service régional, la DRAC, réalise un premier diagnostic de terrain : ce diagnostic (systématique), envoie des archéologues creuser des tranchées sur environ 10 % de la surface du site pour déterminer s’il y a une présomption à des vestiges archéologiques ;
– S’il n’y a pas de présomption de vestiges, l’exploitation peut démarrer. Dans le cas contraire, le conservateur du patrimoine (qui a signature pour le préfet de région) prescrit une fouille en établissant la zone de recherche pour les archéologues.
Près d’un diagnostic sur trois aboutit à une fouille autour de Paris
À titre d’exemple, la carrière de granulats alluvionnaires de l’entreprise A2C Matériaux, située à Grisy-sur-Seine (77), a représenté une source intarissable de découvertes sur 4 000 ans d’histoire, de l’âge du bronze jusqu’à l’Antiquité. Ce site qui couvre 200 hectares est en exploitation depuis la fin des années 80 et a récemment fait l’objet d’une prescription de fouilles portant sur cinq secteurs distincts, d’une surface cumulée de 15 hectares. Les premières fouilles ont permis par exemple de découvrir une nécropole avec un millénaire d’ossements et une ferme gallo-romaine.
"Ce site est extrêmement riche", décrit Thomas Weinbreck, responsable foncier et environnement chez l’exploitant de carrière A2C Matériaux. "Nous avons déjà fini trois des cinq zones de fouilles que nous réalisons petit à petit. Nous devons encore fouiller le cœur d’une ferme gallo-romaine fortifiée, assez énorme pour l’époque."
.png)
La carrière de Grisy-sur-Seine, recelait des vestiges de plusieurs tranches d’histoire. Ci-dessus, le squelette d’une nécropole découverte en 2023. Ci-dessous, un puit datant de l’occupation antique, également découvert en 2023. © A2C Matériaux
.png)
Une fouille ne dure généralement que quelques mois. À son terme, la DRAC vient sur le site pour valider la bonne tenue de l’opération avant de rédiger un courrier de libération des terrains. L’exploitation de la carrière peut alors reprendre, même si en parallèle, les laboratoires d’archéologie continuent de leur côté pendant un ou deux ans d’analyser les vestiges sortis (pour la datation, l’assemblage des morceaux, etc.).
Certaines régions de France sont particulièrement propices à des découvertes archéologiques, notamment dans la vallée de la Seine. "Lorsqu’on réalise le diagnostic initial, je dirais qu’il y a une chance sur trois que celui-ci aboutisse à une présomption de fouille dans la région", estime Thomas Weinbreck. Une probabilité qui est bien intégrée par les exploitants mais la profession souhaite encore améliorer le dialogue avec les métiers de l’archéologie.
Quand les archéologues rencontrent les professionnels des carrières
On peut s’en douter, les problématiques de l’archéologie diffèrent légèrement de celles des exploitants de carrières… C’est pourquoi, les deux secteurs – l’INRAP et l’UNICEM – ont signé une convention-cadre en juillet dernier pour une durée de cinq ans (2025-2030) afin de faciliter le travail des archéologues et donc rendre les fouilles plus efficaces.
Concrètement cela signifie par exemple expliquer aux salariés des carrières le rôle des archéologues ou bien mettre à disposition de ces derniers du matériel comme une pelle pour pouvoir réaliser des tranchées. "Il y a également un travail d’acculturation de nos métiers", précise Olivier Viano. "D’un côté, on rappelle côté aux archéologues les contraintes de sécurité, car on ne peut pas débarquer sur une exploitation la fleur au fusil. Et du côté des exploitants, on leur explique pourquoi une partie de leur exploitation sera immobilisée, pourquoi une opération peut prendre plus de temps que prévu."
Par le passé, une convention avait déjà été signée entre l’INRAP et l’UNICEM de 2018 à 2020 pour faire connaître les métiers dans les deux secteurs. Le projet qui avait connu un temps d’arrêt avec le Covid.
Surtout, la nouvelle convention prévoit que les exploitants informent le plus tôt possible lorsqu’ils savent que le permis d’un nouveau site ou d’une nouvelle extension pourrait bientôt être délivré afin que l’INRAP puisse anticiper les diagnostics à venir sur le territoire français. Une information d’autant plus importante à donner que le délai pour obtenir un diagnostic de l’INRAP peut être long. Un retard qui s’explique surtout par insuffisance de fonds.
.png)
Alain Plantier, Président de l’UNICEM et de l’UNPG et Dominique Garcia, Président de l’INRAP signent le 7 juillet 2025 la convention cadre pour favoriser les échanges entre l’archéologie et les exploitants de carrières. © UNICEM
Des fouilles onéreuses
Si le diagnostic initial est financé par l’INRAP, les fouilles sont quant à elles à la charge des exploitants de carrière. Une opération dont le coût n’est pas négligeable. "Environ 400 000 euros de l’hectare", chiffre Etienne Fromentin de l’UNICEM. "J’ai déjà observé plusieurs cas où les exploitants ont abandonné le gisement en raison de coût." Dans ce dernier cas, les vestiges restent inexplorés sous terre.
En théorie, les carriers peuvent demander une subvention auprès de l’INRAP qui peut représenter jusqu’à 30 % du coût des fouilles. Mais en pratique, très peu de demandes aboutissent, uniquement pour des cas remarquables. L’entreprise A2C Matériaux, mentionné plus tôt, n’a par exemple reçu qu’une subvention de 10 %, car le site présentait un caractère exceptionnel, avec une surface à fouiller plus importante que prévu (8 hectares en plus des 3,2 hectares sur un des sites).
L’INRAP peine déjà à financer la première étape que constitue le diagnostic, en s’appuyant notamment sur la redevance d’archéologie préventive, payée par les exploitants de carrières. Celle-ci représente 71 centimes/m2 en 2025, à payer une seule fois au moment de l’ouverture d’un site mais aussi au moment de ses extensions.
"Cela fait au moins deux ou trois ans que nos entreprises nous alertent que les opérations de diagnostics sont repoussées à l’année prochaine", précise Olivier Viano. "Jusque-là, l’État a réabondé aux ressources financières de l’INRAP ce qui a permis de débloquer les problématiques de diagnostic plus tôt que ce qui était annoncé. Mais chaque année, on tremble un peu à l’idée qu’il n’y ait pas de fonds suffisants."
Pour rappel, la taxe d’archéologie préventive (TAP) est apparue avec la loi du 1er août 2003, soit un an après la création de l’INRAP en 2002. Malgré la progression de la redevance au fil des ans, l’INRAP souffre encore d’un manque de financement, accusant un déficit de 15 millions d’euros en 2024.
L'auteur de cet article