NF DTU 21 – Exécution des ouvrages en béton

Cette fiche prend en compte la dernière révision du document intégrant les évolutions normatives dans le domaine depuis 2004 (en particulier : nouvelle norme NF EN 206-1, NF EN 13670-1, Eurocode 2). ©DR
Publi-Information
Domaine d’application
Le NF DTU 21 “Exécution des ouvrages en béton” vise à donner les conditions de mise en œuvre des ouvrages en béton, en béton armé et en béton précontraint, justifiables des règles de conception et de calcul aux états limites.
Il vise les mêmes ouvrages ou éléments d’ouvrages que ceux définis dans l'Eurocode 2 :
- coulés en place ;
- préfabriqués :
- sur le chantier ;
- en usine ;
- réalisés :
- dans toutes les zones climatiques françaises (y compris les départements d'Outre-Mer) ;
- à l'aide de bétons de résistance caractéristique à 28 jours ≤ 90 MPa.
Le NF DTU 21 ne traite pas, notamment :
- des parties d'ouvrages réalisées à partir :
- de granulats lourds ;
- de béton caverneux ;
- de gros béton ;
- des prescriptions particulières de conception et de mise en oeuvre des ouvrages spéciaux tels que cheminées, cuves, réservoirs, etc. ;
- de la fabrication des éléments préfabriqués couverts par des normes produit ou disposant d’une Évaluation Technique Européenne ;
- de prescriptions particulières relatives à des armatures autres qu’en acier ;
- du béton mis en œuvre par projection.
La version en vigueur de ce NF DTU, à la publication de cette fiche, est celle de juin 2017.
Matériaux visés
Les exigences que doivent respecter les constituants nécessaires à l’exécution d’ouvrages en béton (béton, aciers, armatures, etc.) sont précisées dans la partie 1-2 « Critères généraux de choix des matériaux » du NF DTU 21.
Mise en œuvre : l’essentiel
Conception
Avant le début des travaux, des données essentielles doivent être transmises à l’entreprise pour l’exécution de son marché. Il s’agit notamment :
- des classes d’exposition à considérer au regard de la durabilité de l’ouvrage ;
- des rapports d’études géotechnique et hydrogéologique ;
- du positionnement des incorporations prévues dans le projet ;
- de toutes les hypothèses nécessaires au calcul et au dimensionnement de l’ouvrage.
Sur cette base, l’entreprise de gros œuvre doit être en mesure de fournir, avant le début des travaux, le dossier initial du dossier d’étude des bétons qu’elle va utiliser pour le chantier considéré. Ce dossier doit préciser, notamment, le type de béton (à propriétés spécifiées, à composition prescrite ou à composition prescrite dans une norme, etc.), les exigences de base et complémentaires de la norme NF EN 206, les éléments qui justifient du respect de ces exigences et la description des moyens de réalisation et de mise en œuvre du béton.
Le dossier initial est complété d’un dossier de suivi que l’entreprise de gros œuvre doit établir au fil de l’avancement du chantier.
Les caractéristiques minimales que doit avoir le béton dépendent :
- de l’importance du chantier :
- Catégorie A : chantier de petite importance qui concerne une construction d’au plus R+2 sur un sous-sol. Sauf dispositions contraires indiquées dans les documents particuliers du marché (DPM), ce type de chantier relève de la classe d’exécution 1 selon la norme NF EN 13670/CN ;
- Catégorie B : chantier de moyenne importance avec éléments de dimensions courantes et normalement sollicités : bâtiment d’au plus R+16, ensemble pavillonnaire important, construction industrielle courante. Ce type de chantier engendre une quantité de béton mise en œuvre de 5 000 m3 maximum et relève de la classe d’exécution 2 selon la norme NF EN 13670/CN ;
- Catégorie C : chantier de grande importance à éléments de dimensions courantes et normalement sollicités : bâtiment au-delà de R+16, entrepôt industriel à fortes charges, complexe sportif de grandes dimensions. Ce type de chantier relève de la classe d’exécution 3 selon la norme NF EN 13670/CN.
Pour chacune des catégories, il peut exister des éléments d'ouvrages particuliers (catégorie respectivement PA, PB ou PC) tels que porte-à-faux importants, poteaux élancés, planchers de grande portée, etc.) ;
- des actions de l’environnement sur l’ouvrage (classes d’exposition) : elles sont définies dans la norme NF EN 206-1.
Mise en œuvre
Le béton est mis en œuvre une fois :
- les coffrages et étais, de rigidité suffisante, posés ;
- les armatures fixées entre elles et calées au coffrage (de manière à ne pas se déplacer lors du coulage du béton).
La mise en œuvre du béton ne peut se faire qu’une fois les surfaces et volumes considérés débarrassés de tous corps étrangers. Sauf justification, le délai total entre le début de la fabrication du béton et la fin de sa mise en œuvre ne doit pas dépasser 2 heures (pour une température ambiante voisine de 20°C).
Dans le cas de la mise en œuvre du béton par pompage, la pompe doit être préalablement amorcée avec une barbotine qui ne doit pas être intégrée à l’ouvrage. A la fin du pompage, toute la tuyauterie ayant servie doit être nettoyée. Cette méthode de mise en œuvre est possible pour des distances maximales de pompage d’environ 300 m horizontalement et 100 m verticalement. Au-delà, le matériel et la formulation du béton doivent justifier l’aptitude au pompage du béton sur la distance considérée.
Une fois coulé, le béton, autre qu’autoplaçant, doit être serré par damage ou vibration.
Si elles ne sont pas prévues sur les plans d’exécution, les reprises de bétonnage doivent avoir l’aval de l’ingénieur d’études avant réalisation.
Le béton au jeune âge doit subir une cure et une protection afin de minimiser le retrait plastique et assurer une résistance et une durabilité convenables en surface. Le choix du type de procédés de cure dépendra notamment des conditions climatiques.
Le décoffrage et le désétaiement doivent être réalisés conformément à la norme NF EN 13670/CN.
Selon les tolérances demandées pour l’ouvrage fini, il sera nécessaire de traiter les surfaces de béton obtenues (par exemple au niveau des réservations). Un ragréage pourra même être réalisé.
Contrôles
Tout au long du chantier, l’entreprise de gros œuvre devra réaliser des contrôles, et en particulier :
- sur les aciers et les armatures réceptionnés ;
- sur le matériel qui est utilisé ;
- sur le béton lui-même (aspect visuel, mesures de consistance, etc.).
L'article 8 du NF DTU 21 récapitule les contrôles à réaliser selon la catégorie du chantier.
Tolérances
Les tolérances dimensionnelles de construction sont données dans l’article 10 de la norme NF EN 13670/CN.
Les tolérances de planéité des différents parements sont précisées dans le tableau ci-après :
| Parements | Planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m | Planéité locale (hors joints) rapportée à un réglet de 20 cm |
| Elémentaire | Pas de spécification particulière | |
| Ordinaire | 15 mm | 6 mm |
| Courant | 8 mm | 3 mm |
| Soigné | 5 mm | 2 mm |
Les états de surface correspondants sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
| Etat de surface | Planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m | Planéité locale (hors joints) rapportée à un réglet de 20 cm |
| Brut de règle | 15 mm | Pas de spécification particulière |
| Surfacé | 10 mm | 3 mm |
| Lissé | 7 mm | 2 mm |
N.B. : Cette fiche rapporte l’essentiel du NF DTU 21. Elle ne se substitue en aucun cas à ce document normatif. Pour tout complément souhaité sur ce type de mise en œuvre, consultez le DTU disponible auprès de l’AfnorFNOR ou du CSTB.

- -
- par Mohamed
- 04/10/2016 19:02:56
C'est très intéressant pour une formation adéquate en BTP. Merci.







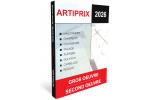


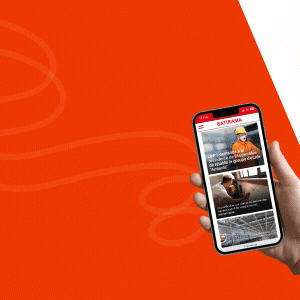
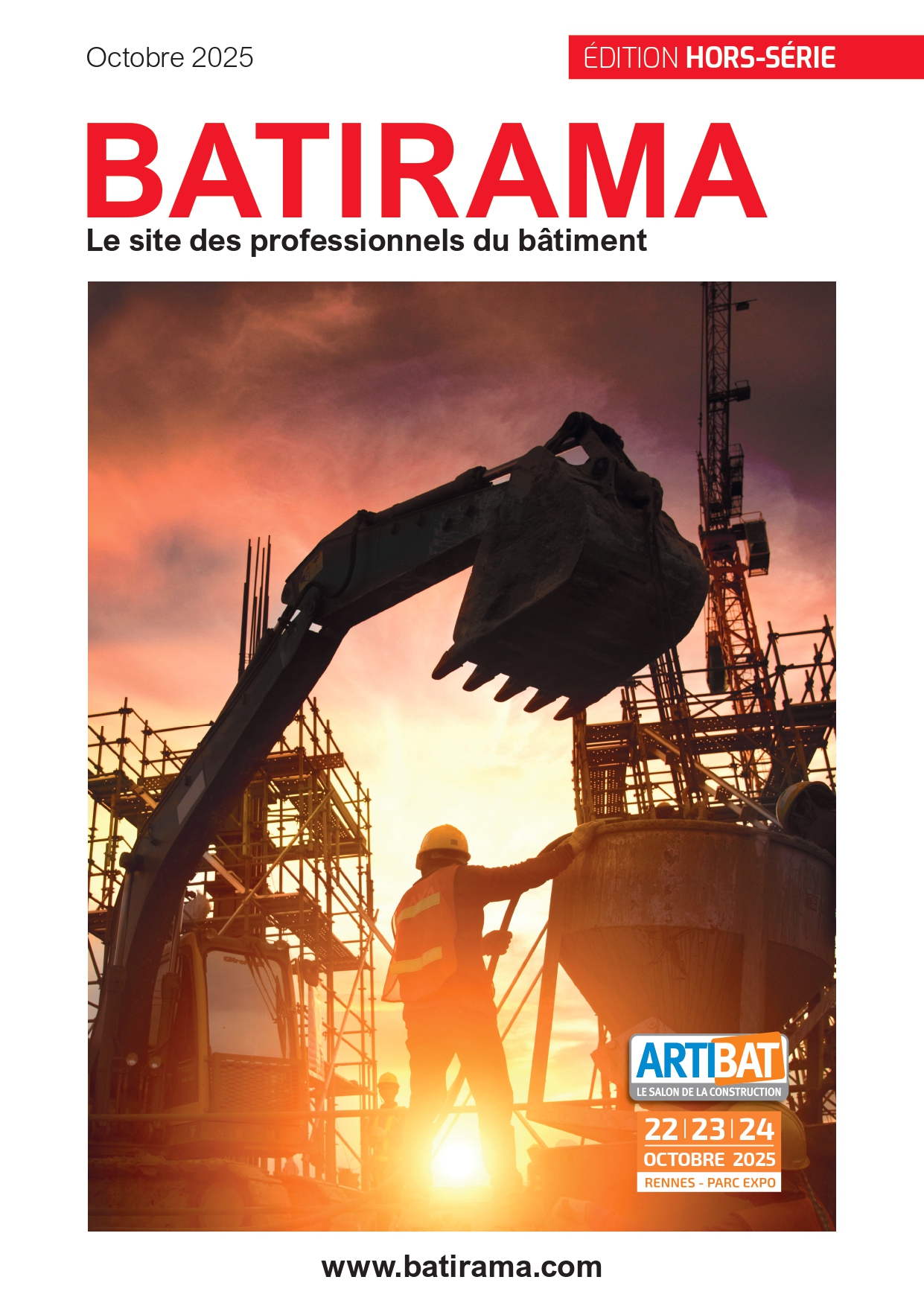
























- -
MERCI RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES