L’adaptation des bâtiments aux fortes chaleurs

Les épisodes de surchaleur se multiplient et s’intensifient. Toutefois, moins de 12 % des bâtiments de logements collectifs en France peuvent y faire face. Il devient donc urgent d’équiper le parc.
Dans un document mis en ligne en mai 2024, l’Ademe rappelle que depuis 2010, seules les années 2024 et 2021 n’ont pas connu de vague de chaleur et souligne que deux fois plus de vagues de chaleur sont à prévoir d’ici 2050.
Pour faire face à ces vagues de chaleur et au changement climatique de manière générale, la France s’est doté d’un Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) qui en est à sa troisième version (PNACC3), un texte de 388 pages. La mesure 9 du PNACC3 – "adapter les logements aux risques de fortes chaleurs" – est décrite à partir de la page 91. On y voit une liste de quatre actions et sous-actions à mener. Tout en bas de la page 96, la sous-action 2.4.1 est particulièrement intéressante. Il s’agit d'insérer "dans le futur guide interministériel sur la réhabilitation énergétique du bâti ancien et patrimonial des recommandations à destination en particulier des Architectes des bâtiments de France pour concilier la protection solaire et le respect de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments et permettant d’assurer une protection solaire minimale". Le ministère de la Culture et la DHUP en sont chargés. Mais rien n’est indiqué quant à la date de complétion de ce plan.
Les toits en zinc n’arrangent rien : ils absorbent facilement la chaleur. Les enduire d’un revêtement réfléchissant est peu efficace si la toiture est déjà isolée correctement sous le zinc. Cependant les PLU interdisent souvent de rehausser la toiture d’une quinzaine de cm, ce qui est suffisant pour ajouter une isolation par l’extérieur. Si une isolation par l’intérieur d’une toiture est toujours possible, elle peut contraindre à trop abaisser la hauteur sous plafond. Ce qui rend le logement difficilement occupable. Dans le cas, en l’absence d’isolation thermique, une peinture réflexive améliore la situation et contribue à la réduction des émissions de chaleur dans l'environnement proche. © PP
Un problème bien documenté dans les bâtiments de logements collectifs
La question de l’adaptation des bâtiments existants aux fortes chaleurs se pose de manière nettement plus aigüe pour l’existant que pour le neuf et, dans l’existant, elle est plus complexe à résoudre en logements collectifs qu’en maisons individuelles ou en bâtiments tertiaires. Les moyens d’action sont pourtant bien documentés.
L'indicateur de confort d’été
Dans la RE2020, le confort d’été est pris en compte par l’indicateur DH. Depuis 2021 dans le DPE, un indicateur de confort d’été est représenté sous la forme d’un smiley – bon, moyen ou insuffisant –, évaluant le niveau d‘adaptation d‘un logement. Cinq paramètres sont pris en compte pour déterminer le niveau :
– la présence suffisante de protections solaires extérieures ;
– L’isolation de la toiture pour les logements au dernier étage et les maisons ;
– L’inertie du logement et son caractère traversant ;
– Et, enfin, l’équipement en brasseur d’air.
Deux études menées par Pouget Consultants
Une étude menée par Pouget Consultants pour le syndicat des industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment (Ignes) sur la base de données DPE de l’Ademe début 2024, montrait que seulement 11,2 % des logements se classaient en bon, 42 en moyen et 47 % en insuffisant. Depuis le 1er janvier 2024, dans le cadre du parcours accompagné de MaPrimeRénov’ en France hexagonale (pour une rénovation d’ampleur), les dépenses associées à l’installation de protections solaires extérieures de baies vitrées et de brasseurs d'air sont éligibles aux aides financières.
De son côté, l’ANCOLS ou Agence Nationale du Contrôle du Logement Social a publié le 9 juillet 2027, une étude réalisée par Pouget Consultants intitulée "L’adaptation des logements aux fortes chaleurs par les organismes de logement social : un enjeu identifié malgré un déploiement contrasté". Elle indique que "plus de la moitié des organismes interrogés mènent néanmoins au moins une des actions suivantes : étude de vulnérabilité du patrimoine, expérimentation de solutions, intégration progressive dans leur plan stratégique de patrimoine (PSP). Les bailleurs les plus avancés représentent moins d’un tiers des organismes interrogés. Ces derniers ont déjà défini une stratégie patrimoniale en prenant en compte le défi de l’adaptation des logements aux fortes chaleurs avec des climats prospectifs". En réhabilitation, poursuivent les auteurs de l’étude, "les bailleurs privilégient alors des solutions dites « simples » et « robustes ». Il s’agit des solutions les plus courantes, en lien avec une logique d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, telles que l’amélioration de l’isolation, la pose de protections solaires de type volets roulants, l’amélioration de la ventilation. les opérations ayant pour objectif premier d’améliorer uniquement le confort d’été (protection solaire fixe, désimperméabilisation des sols et végétalisation des cours, brasseurs d’air, etc.) sont plus rares. En effet, d’après les bailleurs interrogés, l’absence de financement dédié constitue un frein majeur à la généralisation et à l’optimisation de ces pratiques. Les arbitrages budgétaires nécessaires à l’équilibre économique des projets conduisent souvent à l’abandon des travaux d’adaptation au réchauffement climatique au profit d’autres exigences réglementaires".
Bref, on n’y pense pas assez et l’absence de financements dédiés n’aide pas.

Les solutions de ventilation proposées commencent par la ventilation naturelle. Mais la plupart des bâtiments collectifs ne s’y prêtent pas, parce que leurs logements ne sont pas traversants. Il existe depuis plus de 20 ans, une excellente solution née en Allemagne, mais aussi fabriquée par les Français Aldes et Atlantic : la ventilation double-flux décentralisée. Elle est trop peu connue des Maîtres d’Ouvrages et des BE français, sauf des spécialistes du passif, mais offre plusieurs solutions par la ventilation de logements existants dépourvus de ventilation. © PP
Que faire ?
Tous les documents et rapports sur l’adaptation aux fortes chaleurs, notamment le document de l’ANAH "Rénover et adapter les logements aux fortes chaleur" s’accordent sur ce point, il existe mesures efficaces pour combattre les fortes chaleurs, dont les occultations extérieures, l’isolation thermique par l’extérieur, l’amélioration de la ventilation, l’installation de brasseurs d’air et la limitation des apports de chaleur internes.
Dans son rapoprt final "Résilience : Adaptation des Bâtiments aux Changements climatiques" publié en août 2023, l’Ademe dresse une liste plus complète des moyens d’action et ajoute :
– La nature du vitrage, sa transmissivité, son émissivité et ses dimensions ;
– Les casquettes ou protections solaires extérieures fixes ;
– Les revêtements extérieurs de faible absorptivité ;
– Les murs végétalisés ;
– L’isolation réflective ou basse émissivité ;
– Le rafraîchissement radiatif, évaporatif, la climatisation solaire, la climatisation par système à compression, l’effet Peltier, le puits provençal et le géocooling.


Bien dimensionnées, les protections solaires fixes sont efficaces. De plus, leurs éléments peuvent avoir une autre fonction : porter des panneaux photovoltaïques et produire de l’électricité pour le bâtiment où elles sont installées. © PP
Les protections solaires extérieures
Les protections solaires extérieures sont nettement plus efficaces que les protections solaires intérieures. Ces dernières créent en effet un coussin d’air chaud entre la paroi vitrée et la protection intérieure qui fait office de radiateur dans la pièce.
La limitation des apports solaires en utilisant des protections solaires mobiles présente les avantages suivants :
– réduction du rayonnement solaire incident plus importante que pour du vitrage à contrôle solaire,
– solution mature déjà mise en place sur les bâtiments,
– les protections solaires améliorent le niveau de confort des occupants et la productivité au travail.
Les protections solaires fixes peuvent être horizontales (casquettes, avancées de toit…), verticales ou inclinées. Elles sont dimensionnées pour protéger efficacement les vitrages du rayonnement solaire direct en fonction de la hauteur du soleil et de son azimut. Elles limitent les apports solaires en été, tout en laissant passer un rayonnement solaire réchauffant en hiver et du rayonnement diffus pour satisfaire les besoins d’éclairage toute l’année.
Aucune des études que nous avons lues ne mentionne le fait que les ABF (Architectes des Bâtiments de France) s’opposent régulièrement à la mise en œuvre de protections solaires extérieures sur des bâtiments existants.


Dans la synthèse de son étude Résiliance, l’Ademe explique que la "comparaison, pour un même site (Île-de-France) et une même sévérité de canicule (vague de chaleur médiane), entre le bâtiment haussmannien isolé par l’intérieur et un immeuble HLM, plus inerte et isolé par l’extérieur, montre l’influence de l’inertie thermique. Il sera plus facile de protéger les immeubles où une isolation par l’extérieur est possible". © PP
Après avoir lu une bonne partie de la littérature consacrée à l’adaptation des logements aux surchaleurs, nous sommes déçus par sa trop grande généralité ou bien par le choix d’exemples (des logements à Hong-Kong au climat très très humide et chaud, très différent des climats français). Il manque en revanche une évaluation concrète des mesures proposées, sauf en ce qui concerne les protections solaires pour lesquelles le Groupement Actibaie a mis en ligne un calculateur : Caleepso.
À la rentrée, nous vous proposerons une liste des solutions de rafraîchissement actives déployables dans les immeubles collectifs.
L'auteur de cet article






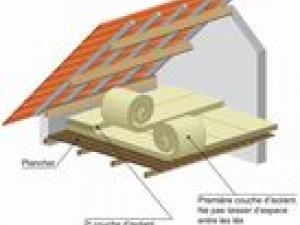


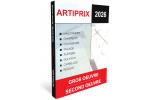


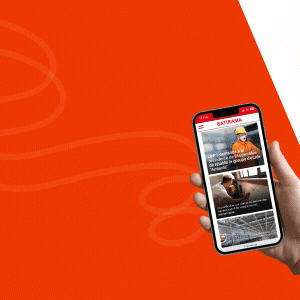
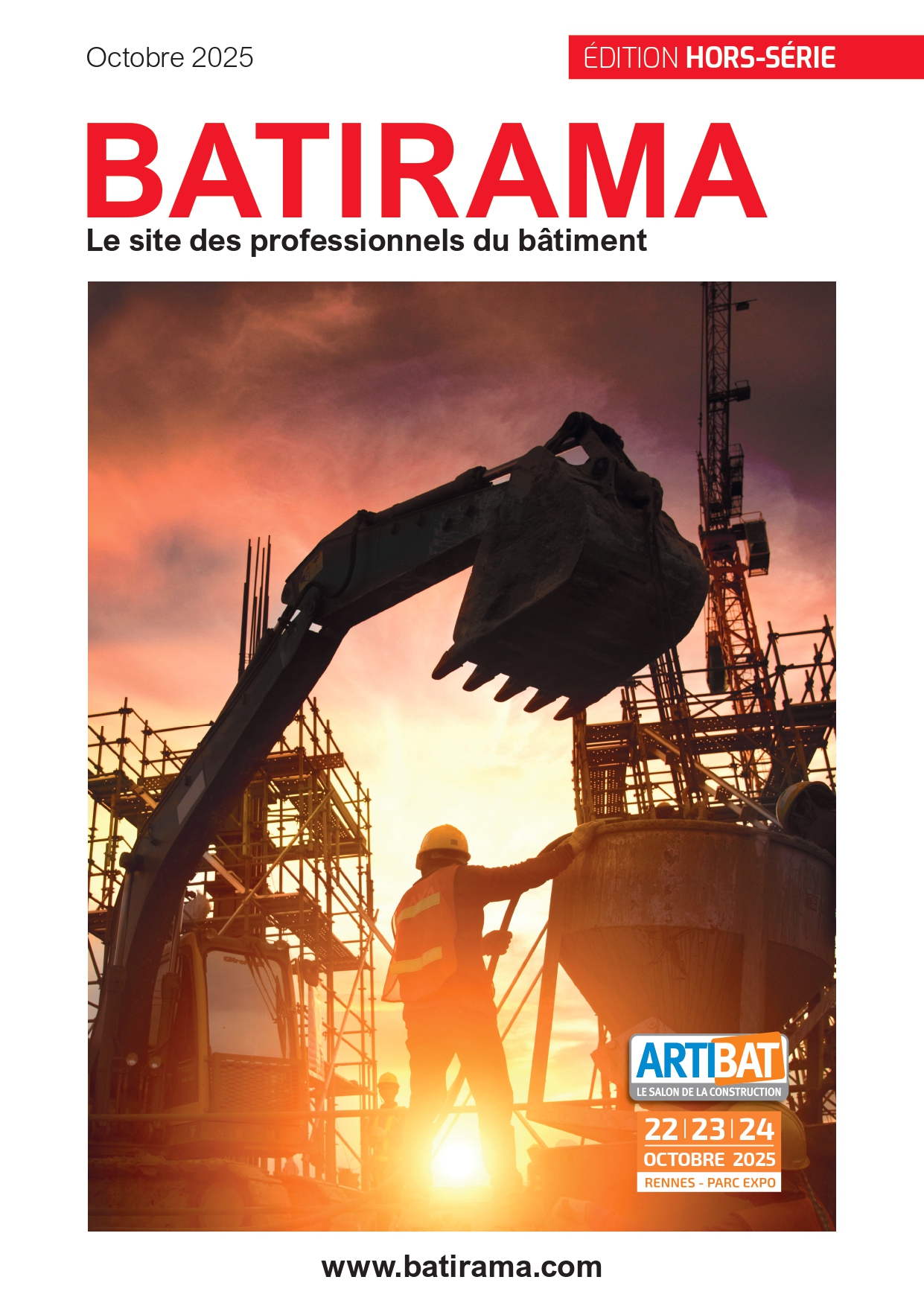



























- -
c'est "décentralisé" qu'il faut écrire en légende de la photo de double flux, et non pas "centralisé" merci